Dialogue entre philosophie et psychanalyse
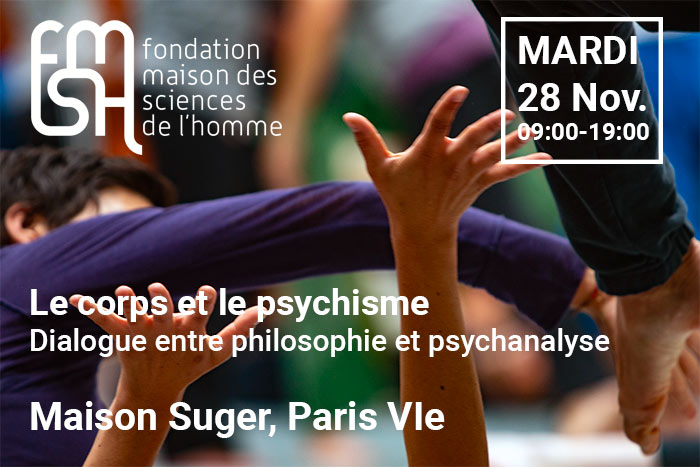
<span style="color:black;">Journée d'étude sous la direction de Petrucia Nobrega (chercheuse invitée du programme DEA, en résidence à la Maison Suger), Clarisse Baruch et Claude Imbert.</span>À partir des années 1950, la production de médicaments efficaces pour le traitement des délires, et plus récemment de la dépression et de l’anxiété, a ouvert la psychiatrie à d’autres domaines de la compréhension du psychisme humain, en particulier la psychanalyse et la philosophie. Cependant, les éditions successives du DSM ont répandu la notion de désordre qui diffère de la conception analytique du fonctionnement psychique et de sa dimension subjective. En s’éloignant des considérations phénoménologiques et psychodynamiques, en restreignant la construction des diagnostics aux descriptions comportementales, le spectre de la pathologie mentale semble englober un nombre croissant d’individus, laissant peu de place à la notion d’une vie normale comportant des oscillations, des hauts et des bas, et les différences liées au caractère unique de certains individus. Quand nous pensons à la normalité comme un exercice continu de normativité, c’est le rapport même entre santé et maladie qui change, puisque ces termes s’opposent sans équivoque. De ce point de vue, être en bonne santé n’est pas la même chose que ne pas avoir de maladies – c’est au contraire être capable de tomber malade et de se rétablir. Il s’agit d’être normatif. La pathologie est inscrite comme faisant partie de la vie et, en ce sens, une vie totalement immunisée contre le pathos n’est qu’une abstraction. […]
